Le Musée d'Art Contemporain (MAC)
Expositions Plastic Butcher d'Anita Molinero et les rois du monde de Mégane Brauer. Exposition Permanente.

1

Anita Molinero est née en 1953 à Floirac d'une mère française et d'un père anarchiste espagnol. Diplômée de l’École supérieure des Beaux-Arts de Marseille en 1977, elle y enseigne pendant plus de 15 ans de 1999 à 2014, marquant par son travail de transmission et son engagement nombre d’artistes séjournant ou ayant séjournés à Marseille durant cette période. L’exposition Plastic Butcher est construite comme une rencontre avec les œuvres manifestes ou inédites d’Anita Molinero de 1998 à aujourd’hui. Elles sont agencées dans un parcours non chronologique conçu selon un principe de correspondances visuelles, formelles ou fictionnelles. Dans les années 1980, Anita Molinero réalise ses premières sculptures dans un esprit grunge. Ses « structures de trottoir », faites de matériaux pauvres de récupération, cartons, mousses, emballages alimentaires, rebus industriels glanés dans la rue, évoquent la précarité et la fragilité. Elle s’intéresse quelques années plus tard, très logiquement, au contenu des poubelles, et non plus seulement à leurs contenants. Son attention se porte à la fin des années 1990 sur la poubelle comme mobilier urbain au service de la collectivité, chargée d’une dimension subversive et symbolique. Le récit de cette exposition commence au moment où s’opère cette transition.
2

3
![Anita Molinero. Onduline, 2024
Plaques de polycarbonate (objets divers)
Courtesy de l’artiste
Production [mac] musée d’art contemporain - Ville de Marseille
Onduline est une œuvre spécialement conçue par Anita Molinero pour le platane qui transperce l’ombrière d'entrée du musée. De la famille des Ondulox, cette série tire son nom du matériau utilisé, l’onduline, une plaque de polycarbonate transparente, auquel l'artiste a ajouté la terminaison ox pour faire oublier le matériau au profit de la fiction, voire de la science-fiction. « Les matériaux que je travaille actuellement, plastiques aux noms étranges et aux composants douteux, à la beauté presque inaltérable, (révèlent) leur dangerosité par la simple violence de la brûlure est en soi métaphorique d’un monde contemporain dans lequel les menaces peuvent prendre la forme évanescente d'un nuage [...]».](./thumbnails/mac-3023.jpg)
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Sans titre (Croûûûtes), 2018. Polystyrène extrudé Collection Philippe Gellman
14
![Sans titre (Croûûûtes), 2018. Polystyrène extrudé Collection Philippe Gellman
Cette œuvre fait partie de la série des « Croûûûtes », dont le titre évoque non seulement la croûte terrestre ou une mauvaise peinture mais également le son que fait le médium quand on le touche ou quand il craque ou brûle (crrrrr). Son aspect quant à lui rappelle plutôt un corps écorché ou calciné. Toutes les plaques polypropylène de la série proviennent d’une entreprise dirigée par une femme trans, amie de l’artiste. Le matériau est travaillé au chalumeau puis au décapeur thermique pour unifier les parties. « Il y a peut- être de l'acétone en plus. Je balance l’acétone et puis je rince. Il y a plusieurs outils de fonte pour créer différentes formes [...]. Ce sont des morceaux de terre brûlée ».
Les « croûûûtes » apparaissent dans le travail d’Anita Molinero dès 2002 sous la forme de murs, de plafonds, de sols ou d'énormes sculptures en forme de blocs. Ce n’est que plus tard qu’elles s’autonomisent de leur environnement pour devenir tableau. Certaines sont encadrées avec du Plexiglass® coloré, d’autres aspergées de couleurs appliquées trop rapidement. L’artiste s’amuse et se moque avec joie de la peinture et ses dogmes.](./thumbnails/mac-3040.jpg)
15

16

17

18

19

20

21

C’est un très étrange défilé de sculptures qui se trouve sur ce podium. On y trouve des objets très différents. Sauras-tu les reconnaître ? Il est parfois difficile de savoir quels objets l’artiste a utilisés avant qu’elle ne leur fasse subir des transformations définitives. Elle étire tellement les matériaux en les chauffant qu’ils s’en trouvent déformés et deviennent monstrueux. Anita Molinero aime les films de science-fiction, tels Mad Max, Alien ou Terminator, dans lesquels on voit des monstres à l’apparence étrange et mutante. Grâce à la sculpture, elle fabrique elle aussi des sujets hybrides qui ont l’air d’être des créatures sorties de fictions. Les cinq œuvres sont ici présentées comme dans un défilé de monstres que l’on appelait au XIXe siècle aux États-Unis des Freak show. Des personnes, souvent différentes par les aspects physiques, étaient montrées dans des foires comme des monstres pour amuser les foules. Dans la collection du musée, tu peux trouver une autre sculpture hydride, un petit monstre blanc de l’artiste Franz West qu’Anita Molinero appréciait beaucoup pour son sens de la provocation et de l’humour. Courtesy de l’artiste et de la Galerie Christophe Gaillard ; Paris, France.
22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47
![Les rois du monde, Chapitre 2 : Ça va déborder (tout éteindre)
Piscine, volets roulants, canapé gonflable
Œuvre produite par le [mac] musée d'art contemporain - Ville de Marseille](./thumbnails/mac-3113.jpg)
48
![Les rois du monde, Chapitre 2 : Ça va déborder (tout éteindre)
Piscine, volets roulants, canapé gonflable
Œuvre produite par le [mac] musée d'art contemporain - Ville de Marseille](./thumbnails/mac-3116.jpg)
49

50

51

52

53

54

55
![CÉSAR
(César BALDACCINI, dit)
1921 Marseille (France)
1998, Parti (France)
Renault 977 VL 06
1989
Voiture compressée
Inv. C.98.10.9. Donation do l'artiste, 1998
César est sculpteur, il a développé une œuvre dans laquelle se détachent quatre procédures majeures, tantôt classique (moulage) et tantôt moderne (assemblage), et les siennes propres : compression et expansion. Formé à rÉcole des Beaux-Arts de Marseille puis de Parte, c'est par manque d'argent quH s'intéresse aux matériaux de récupération. En travaillant la ferraille et les rebuts, I leur donne une seconde jeunesse, héritier en cela de l’esprit Dada’.
Vers la fin des années 1950, César découvre rexistence, aux États-Unis, de presses capables de compresser des voitures. L'arrivée dans les usines Renault de la première presse hydraulique en France, lui permet de réaliser des Compressions d’automobiles (i960) qui sont exposées à Parte, créant le scandale. Laissant dans un premier temps la priorité à foutH, dés 196L il intervient sur le matériau, la couleur, la disposition et le degré de compression lui-même, créant les Compressions dirigées. * J'étais les mâchoires qui écrasaient le mêtaL [_] Dans ma tête, c’est moi qui presse, c'est moi la mochine,)efoès corps avec elle.4
Cette appropriation d'un objet industriel, en fera une des figures des Nouveaux Réalistes. Pierre Restany l’invite en 1960 à se joindre aux artistes signataires (Klein, Arman, Raysse, Villeglé. Hains, etc.) de ce qui sera le manifeste du groupe.](./thumbnails/mac-3088.jpg)
56

57

58

59

60

61
![Richard BAQUIÉ
1952 -1996, Marseille (France)
Projet pour la ville de Marseille. L'Aventure (le café du matin)
1988
Maquette, métal, papier
Inv. 2007.2.4
Transfert de collection de l’état, attribution au (mac] musée d'art contemporain de Marseille en 2008. Dans les années 1980, il découpe et assemble carcasses de voitures, cockpit d'avion, lettres de métal, fabriquant des sculptures assimilable à des machines. Il met à jour des éléments cachés, des rêves d'enfance, une poétique, la relation à l'espace physique, mais aussi mental et géographique en lien avec le déplacement Les mots travaillés comme des objets, nourrissent sa vision de sculpteur et le lyrisme inhérent à toute son œuvre : « J'ai toujours été séduit par le pouvoir des mots et le chiasme qu'ils produisent si vous les mettez sur le même plan que les images. Il s'agit pour les mots comme pour les objets - mais n'est-ce pas la même chose ? - d'appropriation. »
Le mot permet à Baquié de poser la question du pouvoir visuel du langage dans l'art.](./thumbnails/mac-3163.jpg)
62

63

64

65

66

67

68

69

70

71
![Martial RAYSSE
1936, Golfe-Juan (France)
Bird of Paradise
1960
Étudiant en lettres, Martial Raysse renonce à la littérature pour la peinture. À la fin des années 1950, il déploie une activité artistique dans plusieurs registres : poèmes-objets, lectures publiques, mobiles, masques, assemblages d'objets divers présentés dans des boîtes de plexiglas. À partir de sa rencontre avec Arman et Yves Klein, il devient l'un des fondateurs du Nouveau Réalisme Fasciné par la beauté brute du plastique, Raysse développe son concept d'hygiène de la vision qui met en jeu des objets de la nouvelle société consumériste. « J'ai voulu un monde neuf, aseptisé, pur et, au niveau des techniques utilisées, de plain-pied avec le monde moderne ». Après son séjour aux États-Unis, il se rapproche du Pop Art.
Bird of Paradise [oiseau de Paradis] est un assemblage d'objets monté sur une tige, métamorphosé par la profusion colorée des articles de séné qui le composent L'oiseau de paradis renvoie par associations sémantiques et plastiques à la parade, aux plumes, et par extension aux plumeaux, cuillères en plastique, à l'univers de la cuisine, du propre, du neuf, du balai, des flacons LUX (lumière). Ironiquement se tient à hauteur de regard une passoire, miroir ubuesque tendu au spectateur. Si l'oiseau de paradis de la réalité, à l'aigrette et aux plumes spectaculaires, est depuis toujours un spécimen fragile, Bird of Paradise est lui aussi affligé d'une fragilité spectaculaire : (Impossibilité de l'éternelle jeunesse.](./thumbnails/mac-3183.jpg)
72

73

74
![François DUFRÊNE
1930 -1982, Paris (Franc©)
Queen Tana
1965
Dessous d'affiches lacérées, marouflées sur fond blanc
Inv. C.86.43 Achat. 1986
Transfert de collection de l'État, attribution au [mac] musée d'art contemporain de Marseille en 2008. Poète, François Dufrêne adhère de 1945 à 1953 au Lettrisme, créant un mode de poésie phonétique qu'il nomme Ultra-lettrisme. Utilisant un magnétophone comme une sorte de stylo vocal, il invente en 1953 les Crirythmes, improvisations enregistrées de sons venus du souffle, de la gorge, de la langue. Il s'inscrit ainsi dans la lignée des travaux sonores dadaïstes de Raoul Hausmann ou de Kurt Schwitters et sa Ursonate. En tant qu'artiste plasticien, il a révélé, à partir de 1957, avec ses « dessous d'affiches », un œil de peintre attentif aux plus grandes subtilités de la couleur.](./thumbnails/mac-3191.jpg)
75
![François DUFRÊNE
1930 -1982, Paris (Franc©)
Triptyque de Nantes
1981
Dessous d'affiches marouflées sur toile
Inv. 20072.11.1 à 3
Transfert de collection de l'État, attribution au [mac] musée d'art contemporain de Marseille en 2008. À partir de 1960, il participe à toutes les manifestations des Nouveaux Réalistes. François Dufrêne est le témoin exemplaire d'une génération d'artistes qui ont en commun un intérêt extrême pour le langage et sa déconstruction. Les dessous d'affiches, qu'il collecte et élabore, forment la face picturale d'un effort global de détournement et de « grattage » qu'il applique de la même façon au texte lui-même. Si Hains et Villeglé préfèrent exposer les déchirures et les lacérations opérées par les passants anonymes sur l'endroit des affiches, Dufrêne choisit quant à lui d'en présenter le dessous. Il donne à lire une espèce de palimpseste qui, conjuguant le mutisme du mur et la communication désagrégée du papier imprimé, révèle la continuité temporelle entre les diverses strates du matériau II revendique son intervention en tant qu'artiste par le fait du « choisissement »et du travail opéré sur l'affiche collectée. Dans tous les domaines qu'il aborde, Dufrêne révèle le passage poétique des matières aux images qu'elles suscitent, dans un souci constant d'établir une relation entre ses œuvres plastiques et sa poésie.](./thumbnails/mac-3189.jpg)
76
![Jean TINGUELY
I925, Fribourg (Suisse) 1991 Berne (Suisse)
Rotozaza I
1967
Métal bois, moteurs, transformateurs et ballons
Inv. 2007.2.42
Transfert de collection de l’état,. attribution au (mac] musée d'art contemporain de Marseille en 2008. Œuvre restaurée en 2013 avec le concourt du ministère de la Culture, Paris.
La formation de Jean Tinguely se portage entre la fréquentation irrégulière des Beaux-Arts de Bâle et l'apprentissage de la décoration de magasins. À Paris; en 1953,9 réalise des reliefs animés dont le mécanisme est caractéristique des machines à dessiner qu’il produira plus tard. Il est le créateur d'un monde de bruit et de jeu de bricolage et d’ombrea Construites en partie à l’aide d’objets de récupération ses mécaniques; délibérément imparfaites; refusent le culte de l’objet neuf, produit d’une société de consommation En 1960, Tinguely intègre le groupe des Nouveaux Réalistes. À partir de 1963, il peint ses machines en noir, les privant ainsi de leur caractère d’objets trouvés.](./thumbnails/mac-3177.jpg)
77
![Jean TINGUELY
I925, Fribourg (Suisse) 1991 Berne (Suisse)
Rotozaza I
1967
Métal bois, moteurs, transformateurs et ballons
Inv. 2007.2.42
Transfert de collection de l’état,. attribution au (mac] musée d'art contemporain de Marseille en 2008. 1967 voit la naissance des Rotozazas. Les machines deviennent elles-mêmes des jeux, les objets récupérés qui les composent sont intégrés dans un être animé dont les membres ont perdu leur identité première… Ancrée au sol Rotozaza appréhende l’espace. Elle oriente lentement sa trompe avide dons « un geste de mendicité» comme le note Tinguely. Où qu’il soit le spectateur entre dans le champ de la machine qui doit être alimentée en ballons; afin de les recracher au ciel dans un bruit de ferrailles. Les dernières machines de Tinguely, dans les années 1980, ajoutent crânes et ossements ou métal révélant la part sombre de son ironie.](./thumbnails/mac-3179.jpg)
78

79

80

81

82

83
![François MORELLET
1926 - 2016, Cholet (France)
Superposition et transparence, tableau incliné à 5° devant l'angle d'un mur
1979
Peinture acrylique blanche, bande adhésive noire sur toile
Inv. C.9L4 Achat, 1991
Restauré en 2021 avec le concours du ministère de la Culture, Paris.
À propos de ses tableaux, Morellet expliquait en 1981 : «Pendant vingt ans, j'ai cru que mes tableaux étaient des plans et que mes lignes étaient des droites. Avec une bonne volonté méritoire, je cherchais, à cette époque, dans mes tableaux : - à obtenir la surface plane idéale en évitant tout relief, toute matière, - à rendre mes plans infinis, c'est-à-dire à les pousser à envahir les murs, en supprimant ce qui avait été créé justement pour les séparer : cadres ou baguettes et présentation oblique, détachée du mur. […] Depuis quelques années […] je m'aperçois qu'entre la géométrie et moi il y a beaucoup de choses (la peinture, le tableau, le mur, etc.) que je ne veux plus ignorer. »](./thumbnails/mac-3199.jpg)
84
![Paul THEK
1933 - 19681 New York (États-Unis)
Untitled
1966
Cire, plexiglas, jaune fluo, métal, formica blanc.
Inv. C.97.5 Achat, 1997.
Paul Thek fait ses études à l’Art Students League, au Pratt Institute et à la Cooper Union à New York. Il construit dès la fin des années 1950 une œuvre dont l’importance sera reconnue par les générations suivantes. Elle se manifeste sous la forme de poésies, dessins, peintures, sculptures, installations et environnements; autant nourrie de peinture italienne classique et baroque que de culture psychédélique. Thek revendique les processus évolutifs.
Il s'engage dans des pratiques de moulage en cire; notamment de son propre corps qui met en scène dans The Tomb [le tombeau] en 1967.
En 1960, i1 crée Where Are We Going ? [Où allons-nous?] Le principe de travail de cette œuvre; en permanente transformation, relève de l’atelier et du lieu de vie. Une œuvre monumentale éphémère qui est impossible de reconstituer. Recycleur des grands mythes comme ceux de la Tour de Babel, du Radeau de la Méduse et des manifestations religieuses, il a produit également des séries de peintures et des sculptures. Untitled appartient â une série initiés en 1964; intitulée Reliquaires Technologiques. Cet objet constitué de formes géométriques, de matériaux produits en usine; place le spectateur face à une œuvre qui s’imposerait par sa froideur, si ce n'est la présence à hauteur du regard, d’un fragment rappelant une cire anatomique. Thek, incorpore dans cette colonne; les apparences crues de la chair humaine. Cette matière hybride, relevant à la fois de l’organique et de la technologie; vient perturber l’expérience de cette sculpture à l'aspect minimaliste. Telle une Vanité contemporaine, cette œuvre invite également à une méditation sur la mort](./thumbnails/mac-3124.jpg)
85
![Alain JACQUET
1939, Neuilly-sur-Seine (France) 2008, New York (États-Unis)
Huile sur toile
Inv. C.85.18 Achat, 1985
Au début des années 1960, après deux années passées à étudier l'architecture à Paris, Alain Jacquet s'installe à New York. Il y rencontre les artistes du Pop Art Intéressé par les images et leur circulation, son travail s'appuie avant tout sur la citation, tant avec la série des Camouflages (1962-1963) qu'à travers ses travaux de Mec Art1 Jacquet est l'une des figures de ce mouvement avec son emblématique Déjeuner sur l’herbe de 1964. Il s'approprie des images célèbres en réalisant des peintures qui laissent apparaître la trame de la sérigraphie. En exacerbant les effets techniques de la reproduction, comme le grossissement des points et des trames, Jacquet réactualise des chefs-d'œuvre à la manière des publicités américaines de l'époque.
Jumping Rope [Corde à sauter], appartient à l'une des séries, initiées au début des années 1970, de tableaux inspirés par les photographies de la NASA. La toile combine une figure de bouc légendaire, mi-humaine mi-animale, et une vue de la terre prise au travers du hublot d'une capsule spatiale. Prenant le parti d'une peinture à la touche assumée, les deux images se mêlent, l'une et l'autre devenues indiscernables, Inextricables, joignant le mythe à la technologie la plus en pointe.
Le Mec Art (Mechanical Art) est un courant artistique apparu en 1963 en Europe Les œuvres utilisent les procédés photographiques de report de clichés sur supports variés, par l’intermédiaire de techniques mécaniques de reproduction. Ces clichés peuvent être tirés de magazines, d’images publicitaires, etc.](./thumbnails/mac-3128.jpg)
86

87
![Bob WILSON
(Robert WILSON, dit)
1941, Waco (États-Unis)
Medea en 3 actes
1971
Mine de plomb, fusain, pastel sur papier
Inv. 2007.2.45 à 47
Transfert de collection de l’état, attribution au [mac] musée d’art contemporain de Marseille en 2008.
Après avoir étudié au Texas et à Brooklyn, Bob Wilson suit une double formation de peintre et d'architecte d'intérieur, dont son œuvre dessinée porte la marque.
Il crée ses premiers spectacles à partir de 1969 à New York. La consécration internationale vient lors de la présentation au Festival de Nancy en 1971 du Regard du sourd. Son travail s'exerce alors pour l'opéra, au travers de ses nombreuses mises en scène de Richard Wagner, et le théâtre, avec un intérêt constant pour l'œuvre de William Shakespeare et d’Heiner Müller.
Medea [ Médée ] 1982 est le fruit d’une première collaboration de Bob Wilson avec Gavin Bryars. Révisée en 1984, c'est aussi la première œuvre de Wilson utilisant comme source un ouvrage classique. C'est un opéra au sens traditionnel, écrit dans un langage musical tonal.
Medea en 3 actes, est une suite de visions abstraites et sombres travaillées à la mine de plomb qui décrivent une sorte d'espace mental. Elles traduisent graphiquement des lieux incertains qui tranchent radicalement avec l'absolue clarté de ses espaces scéniques. Le dessin semble avoir toujours été chez lui un moyen de nourrir et de prolonger le travail qu’il mène sur scène. Prenant source dans les opéras et les pièces qu’il dirige alors, les dessins cherchent à traduire dans l’espace de la feuille un ensemble de sensations.](./thumbnails/mac-3131.jpg)
88
![Gabriel OROZCO
1962, Veracruz (Mexique)
La D.S. 1993
Voiture Citroën DS19 de 1970 reprofilée.
Inv. FNAC 94003
Centre national des arts plastiques Dépôt au [mac] musée d'art contemporain de Marseille.
Vit et travaille à New York (États-Unis), Paris (France) et au Mexique
Fils d'un peintre muralista, nourri d'art et d'engagement politique, Gabriel Orozco étudie à l’Escuela Nacional de Artes Plásticas (Mexico) entre 1981 et 1984 puis au Circulo de Bellas Artes (Madrid). Il découvre, lors de son arrivée à Madrid des artistes conceptuels tels Robert Smithson ou Gordon Matta-Clark. Artiste sans atelier, Orozco utilise des carnets de croquis, de photographies et de notes, il met à Jour les relations entre intimité et monde extérieur.
La D.S. est la première pièce d'un ensemble consacré à de véritables mythologies de la circulation urbaine. Elle demeure l'œuvre la plus emblématique d'Orozco : la récupération, l'histoire, le jeu, la sculpture y sont convoqués. Il fait le choix délibéré d'un véhicule futuriste à l'époque de sa conception, qui garde dans l'inconscient collectif une aura d'exception. Quarante ans après son apparition sur les routes françaises, comme voiture présidentielle et dans le cinéma de la Nouvelle Vague, La D.S fait l'objet d'un second design. Le véhicule est découpé en trois morceaux. La partie centrale disparaît les parties latérales sont assemblées l'une avec l'autre. L'impression de vitesse est accentuée, mais, sans moteur, la voiture - plus que le symbole d'un déplacement - devient celui d'un instantané, figé. Orozco la soumet à un processus qu'il nomme « extraction et reconfiguration ». Il s'agit d'un geste minimal, pensé, sculptural, presque modeste : le geste de celui qui depuis toujours préfère modifier que créer du neuf.](./thumbnails/mac-3132.jpg)
89

90
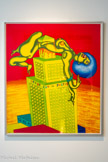
91

92
![Rainer FETTING
1949, Wilhelmshaven (ABemogne)
Gary Head
1966
Huile sur toile
Inv. C.86.39 Achat 1986.
Rainer Fetting suit d’abord une formation de charpentier avant d'étudier à l’Académie des Arts de Berlin de 1972 à 1978 où il rencontre le peintre Salomé en 1974. Pendant leurs études; ils deviennent militants dans le mouvement de libération gay et lesbien, actif au début des années 1970. Le désir de changement social et l’acceptation publique de leur homosexualité se reflètent également dans leurs travaux. En traitant de l'identité et de la sexualité dans leur art, Salomé et Fetting ont apporté d'importantes contributions aux discours queer de l'époque.
Avec Salomé et Luciano Castelli - qui fondent en 1980 le groupe punk Geile Tiere [Animaux excites] - il entreprend en 1982 une tournée de concerts-performances à travers la France.
En 1977,3 crée avec un groupe d’artistes — Salomé, Helmut Middendorf, Bernd Zimmer, entre autres - la galerie am Moritzplatz, où il organise ses premières expositions. Le groupe devient célèbre en tant que fondateur du style Neue Wilde [Nouveaux Fauves], qui prône une approche expressive de la production artistique; se distinguant de l’intellectualisme et de la sévérité formelle de l’Art minimal qui domine la scène artistique à l'époque. Son travail pictural se caractérise par des coups de pinceaux larges et rapides et son utilisation audacieuse de la couleur. Fetting reconnaît l'influence des peintres du fauvisme comme celles de Vincent van Gogh, Paul Cézanne et Pablo Picasso, dans la lignée de l'avant-garde européenne.](./thumbnails/mac-3144.jpg)
93
![Jean-Michel BASQUIAT
I960 -1988, New York (États-Unis)
King of the Zulus
1984-1985
Acrylique sur toile, pastels gras et photocopies sur papiers contrecollés
Inv. C. 86.39 Achat, 1986.
Enfant de la classe moyenne, Jean-Michel Basquiat est très tôt encouragé par ses parents à cultiver sa fibre artistique. Il acquiert une visibilité sur la scène new-yorkaise fin 1978. Dans un contexte où le tag et le graffiti sont devenus un phénomène urbain et avec eux le hip hop, Basquiat opère une synthèse entre l'expression codée des gangs et les souvenirs de ses visites de musées. En 1980, il se lie d'amitié avec Andy Warhol avec lequel il réalisera plusieurs toiles entre 1983 et 1985. La fulgurante reconnaissance de Basquiat coïncide avec l'émergence du Bad Painting aux États-Unis et de la Figuration Libre en France.
King of the Zulus [Le roi des Zoulous] est tout d'abord le titre d'un morceau de Louis Amstrong. S'il pointe un ailleurs exotique, son primitivisme est l'écho contemporain de la Nation Zulu, branche non violente du Hip Hop. Peintre de la mégalopole, Basquiat transpose au tableau la technique instrumentale de l'échantillonnage, combinant des fragments de mots, d'images et de symboles comme autant de samples visuels. Le recours à la photocopie couleur - procédé alors nouveau - lui permet d'opérer des reprises de dessins antérieurs et d'inscriptions empruntées à différents champs du savoir. Ce réseau de signes éclectiques et de motifs récurrents, constitue le fond d'où se détache la figure humaine, thème central dans son œuvre, indissociable pour lui de l'environnement social et culturel, orchestré par la toute puissance de l’information.](./thumbnails/mac-3146.jpg)
94

95

96
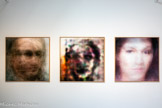
97
![Lourdes CASTRO
1930 - 2022, Funchal (Portugal)
Ombre portée linhof, blanc et fumé
1968
Plexiglas découpé et peint
Inv. C.68.2.18 Achat1968
Après des études à l'École des Beaux-Arts de Lisbonne, Lourdes Castro et l'artiste René Bertholo, son mari, s'installent à Paris en 1958. Ils fondent cette année-là, avec d'autres artistes portugais, la revue internationale KWY, revue d'art et de poésie publiée jusqu'en 1964. Castro participe à la première Biennale de Paris en 1959.
' Après une courte période picturale, Castro réalise des Objets, assemblages d'éléments du quotidien inspirés du Surréalisme et des Nouveaux Réalistes. Associant objet et impression sérigraphique, elle réalise ses premiers Contours en 1959. Dès lors, elle va capturer les ombres projetées de personnes de son entourage, qu'elle trace tout d'abord sur des tableaux à l'huile avant d'adopter à partir de 1964 le plexiglas qu'elle peint découpe ou sérigraphie […] Parallèlement depuis les années 1960, elle constitue une encyclopédie des ombres, qu'elle appelle ses Albums de Famille et dans lesquels elle recueille et colle toutes sortes d'éléments visuels et textuels reliés de près ou de loin au thème.
Ombre portée linhof, blanc et fumé est un bas-relief résultant de la superposition de plusieurs plaques de plexiglas. Dans cette œuvre, la projection au mur d'une silhouette peinte sur le support transparent semble démultiplier l'ombre de celle-ci. L'aplat de couleur matérialise le négatif d'une présence tout en saisissant un moment éphémère. En l'occurrence, la prise de vue d'un photographe cherchant à capturer l'instant](./thumbnails/mac-3138.jpg)
98
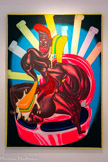
99
![Franz WEST
1947-2012, Vienne (Autriche)
Kleine Lemure
2001
Aluminium, peinture blanche
Inv. C.02.14 Achat, 2002.
Kleine Lemure appartient à la série des Lemurenkôpfe (Têtes de Lémures) initiée à l'occasion d'une commande de la ville de Vienne en Autriche qui désirait des sculptures naturalistes pour orner un pont de la ville. Leur nom provient des Lémures, âmes des morts qui, dans l'Antiquité romaine, venaient hanter les vivants.
«J'aime beaucoup boire et parfois, lorsqu'on se réveille le matin, on a mal à la tête et on voit dans les draps toutes sortes de visages étranges; on dit alors que vous voyez des lémures et ils sont très réalistes. Les Lémures proviennent des Saturnales, la fête de Carnaval chez les Romains […] Dans le folklore aussi, il y a des Lémures, mais c'était également un terme qu'on utilisait pour le simple peuple et ils sont à moitié singes, à moitié hommes.»
Dans un travail nourri de psychanalyse autant que de philosophie, Franz West développe une œuvre interrogeant notre rapport au corps, dans ses dimensions sociales et esthétiques, avec un esprit humoristique, anticonformiste et parfois cruel.](./thumbnails/mac-3152.jpg)
100

101
![CHRISTO et JEANNE-CLAUDE
(Christo JAVACHEFF et Jeanne-Claude DENAT DE GUILLEBON, dits)
1935, Gabrovo (Bulgarie) 2020, New York (États-Unis)
1935, Casablanca (Maroc) 2009, New York (États-Unis)
Valley Curtain
1970-1972
Poster en couleur sur papier
Inv. C.75.1.40à43
Don de l’artiste, 1970 Restauré en 2022 avec le concoure du ministère de la Culture, Paris.
De 1953 à 1956, Christo étudie à l'Académie des Beaux-Arts de Sofia, puis à Vienne. En 1958, il se rend à Paris, il y fait la connaissance d'artistes qui formeront en 1960 le groupe des Nouveaux Réalistes. Il se marie avec Jeanne-Claude Denat de Guillebon avec qui il fera ensuite œuvre commune. Ils se fixent à New York en 1964. À la fin des années 1950, l'empaquetage devient le geste récurrent de l'artiste. À l'aide de tissu et de cordes, Christo, en emballant des objets, les transforme, en révèle la familière étrangeté. Il empêche l'usage normal de ce qu'il laisse deviner et pose la question de l'essence môme de l'œuvre d'art : de quoi est-elle faite ?
Christo et Jeanne-Claude sont connus pour avoir mené des projets de grande envergure. Le principe d'empaquetage s'étend à des interventions directes et temporaires sur des édifices publics, des monuments ou des paysages entiers. Cela pose des problèmes techniques, financiers (en partie résolus par la vente des dessins préparatoires de chaque projet), mais surtout juridiques, qui ne leur permettront d'entreprendre de telles opérations qu'à la fin des années 1960.
Les 4 affiches de Valley Curtain [Le rideau de la vallée] sont des photographies reproduites de l'œuvre prises de différents points de vue. Elles témoignent de la dimension gigantesque de ce rideau de 381 mètres de largeur sur 111 mètres de hauteur tendu à travers les montagnes Rocheuses dans le Colorado. Christo et Jeanne-Claude créent des œuvres à l'échelle du paysage.](./thumbnails/mac-3159.jpg)
102

103

104

105

106

107

108
